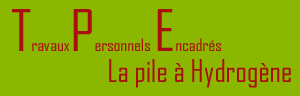
Thomas Morzadec
Nicolas Coustaury
Avit Guirimand
Quels sont les obstacles au
developpement de la pile à hydrogène ?
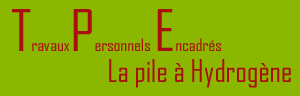
Thomas Morzadec
Nicolas Coustaury
Avit Guirimand
Quels sont les obstacles au
developpement de la pile à hydrogène ?
En savoir plus sur la production
En savoir plus sur la sûreté et le stockage
En savoir plus sur le transport et la distribution
A la base est la production. Ainsi obtenir de l’hydrogène à partir du vaporeformage de combustibles riches en hydrogène comme le sont le méthane ou le méthanol se fait avec les meilleurs rendements énergétiques qui peuvent atteindre 90% (les pertes étant essentiellement thermiques). Les auteurs remarquent alors que la quantité totale de dioxyde de carbone émise est supérieure lorsqu’on a recours à l’hydrogène mais ne mentionnent pas que dans ce cas ces rejets sont concentrés en un seul lieu et peuvent être traités par capture et séquestration opérations impossibles avec une utilisation diversifiée des autres combustibles.
En revanche, pour l’électrolyse, Eliasson et Bossel avancent un rendement au mieux de 75%, valeur un peu faible car il peut aller jusqu’à 80 voire 85%.
Vient ensuite le « conditionnement » de l’hydrogène soit sous forme de gaz comprimé soit sous forme de liquide, il entraîne une dépense supplémentaire d’énergie. Concernant la compression adiabatique, la perte correspondante en énergie disponible est de 10 à 15% entre 20 et 80 MPa alors qu’elle n’est que de quelques pour-cent pour le méthane dans les mêmes conditions Pour liquéfier l’hydrogène, l’énergie requise est encore plus importante surtout pour les petits liquéfacteurs. Toujours évaluée en perte de pouvoir énergétique cette dépense d’énergie va de 150% de perte pour les unités produisant quelques kg d’hydrogène liquide par heure à seulement 30% pour celles produisant au moins 1 T/heure. Le stockage dans les hydrures parce que peu développé et correspondant à beaucoup de cas particuliers ne permet pas d’avancer des évaluations chiffrées sur les quantités d’énergie qu’il requiert. Mais sachant que l’hydrogène doit au préalable être comprimé et que pour le récupérer l’hydrure doit être chauffé, la quantité d’énergie à mettre en jeu sera intermédiaire entre celle que demande la compression et la liquéfaction.
Concernant le transport par route Eliasson et Bossel n’examinent que le cas du transport de l’hydrogène comprimé. En raison du poids élevé des réservoirs haute pression et de la faible densité de l’hydrogène, un même camion de 40 T transporte dix fois moins d’hydrogène que de méthane et près de 80 fois moins d’essence. La quantité d’énergie pour le transport étant proportionnelle à la distance parcourue, le résultat est que pour 500 km l’énergie dépensée est équivalente à celle transportée ! Des conditions peu réalistes qui ne sont guère améliorées par le recours à des camions à pile à combustible. Seul un camionnage d’hydrogène à l’état liquide emmenant une quantité cinq fois plus importante avec le même véhicule semblerait acceptable. En fait, pour transporter du gaz comprimé c’est le gazoduc qui est le plus raisonnable car il demande une dépense d’énergie pour 150 km de seulement 1.4% du pouvoir énergétique de l’hydrogène transporté, énergie consommée par les pompes hautes pression placées le long du réseau pour assurer un débit constant du gaz.
La production de l’hydrogène à partir de l’électricité réclame de l’énergie pour l’électrolyse de l’eau et pour la compression du gaz obtenu. Les auteurs, là encore, l’ont évaluée en perte de pouvoir énergétique. Elle varie de 75% à 40% pour des quantités d’hydrogène produites allant de 1 700 à 34 000 kg par jour moyennant des alimentations électriques de 5 à 81 MW.
A la lumière des bilans énergétiques de la distribution, force est de constater que l’hydrogène doit être transporté le moins possible et surtout pas par route. Pour les grosses quantités, le transport sous la forme liquide est envisageable mais à condition d’utiliser plutôt le chemin de fer et/ou les voies d’eau. En fait, c’est le gazoduc qui s’avère être la meilleure solution. Pour la production à partir de l’électrolyse dans des petites unités, la dépense relativement importante en énergie qu’elle demande privilégie le choix des énergies renouvelables (solaire ou éolienne) qui sont non polluantes et gratuites. Les productions moins exigeantes en énergie comme celles issues du vaporeformage ont, elles, intérêt à être centralisées en de grosses installations et ce d’autant, qu’il est alors plus facile d’envisager de leur adjoindre des dispositifs de capture et de séquestration du dioxyde de carbone qui résulte de ce procédé de production.
Après ce bilan, on peut ce demander quel est l’intérêt de l’hydrogène :